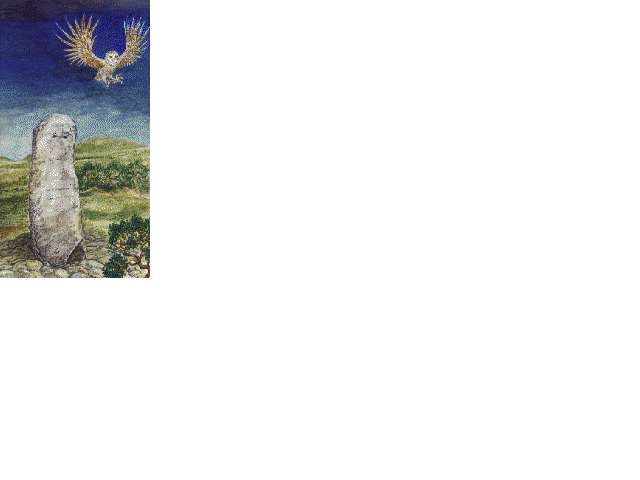
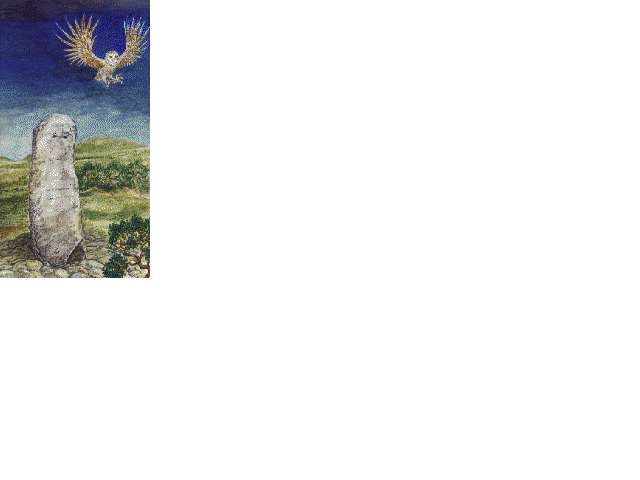 |
|
(Texte
paru dans le Bulletin de la Société Préhistorique
Française - 1995)
Résumé
C'est au cours d'un travail de
prospection sur la commune de Puyvalador, dans les Pyrénées-Orientales,
à la demande d'élus locaux désirant mettre
en valeur le patrimoine, qu'a été découverte
une statue-menhir d'un type particulier. Il s'agit d'une statue-menhir
isolée de tout groupe identifié. Son ornementation
ne permet pas de la classer dans un des groupes les plus proches
tels que les groupes du Languedoc ou du Rouergue.
Abstract
It's in the course of works to
prospection in the township of Puyvalador, in the county of Pyrénées-Orientales,
on demand to the local elect desirous to develop patrimony, that
has been finding a statue-menhir of special model. It's a question
of statue-menhir isolated of indentify group. This decoration
is not enable to class in the near group like the Languedoc group
or the Rouergue group.
Si le département des Pyrénées-Orientales
est un département actif en matière de recherche
archéologique, la répartition des archéologues
sur son territoire est assez inégale.
Passant rapidement de la mer à
la montagne, les espaces naturels sont très différents
les uns des autres, certains étant plus accueillants que
d'autres. A part quelques exceptions près, la recherche
s'est souvent cantonnée dans la plaine du Roussillon ou
dans les massifs arides de l'Albères, du Conflent ou des
Aspres. Rares sont les chercheurs qui travaillent en haute altitude.
Aussi, il n'est pas étonnant d'y faire des découvertes
inattendues. C'est le cas de la statue-menhir qui a été
retrouvée sur la commune de Puyvalador en Capcir.
La découverte isolée d'une
statue-menhir dans le département des Pyrénées-Orientales
est assez significative pour être mentionnée. Cette
statue se trouve sur la commune de Puyvalador en Capcir (Canton
de Mont-Louis) dans l'extrémité occidentale des
Pyrénées-Orientales. Elle s'inscrit dans un paysage
de douces collines sans relief qu'un soleil fréquemment
voilé rend un peu mornes. L'atmosphère est brumeuse
lorsque le “ Carcanet ” qui monte du pays
de Sault et du Donnezan ne souffle pas.
La statue-menhir se situe dans la partie
sud-ouest d'un monticule qui domine la rivière de l'Aude
au lieu-dit “ Caramat ”. Elle se trouve en
bordure d'un champ. Les métayers l'ont découverte
en 1992, à la suite d'un défonçage profond
dans la partie basse de ce champ. Ils l'ont ensuite transportée
sur le côté du champ pour s'en débarrasser.
Avant son exhumation, la face était tournée vers
le sol et n'a donc pas subi les aléas d'une mise en culture
intensive.
Le site se trouve sur le tènement
sud-ouest d'un mamelon appelé Caramat, dont le sommet se
trouve à l'altitude de 1581 m. Il domine au nord/nord-ouest
le bassin sédimentaire de Puyvalador, aujourd'hui recouvert
en partie par une retenue d'eau artificielle. Il est bordé
de champs et entouré de hautes crêtes boisées.
Au sud-ouest s'élève le Puig Péric jusqu'à
une altitude de 2810 m.; au nord, les sommets qui encadrent le
col des Hares et la sombre forêt du Carcanet ferment l'horizon.
Le bassin du Capcir possède une origine tectonique attestée
par l'abrupt de sa bordure est qui tranche tous les affleurements
géologiques perpendiculaires. Il doit s'agir d'une dépression
sculptée par les glaciers du Carlit lors de la première
glaciation. Ainsi s'expliquerait son orientation nord-sud complètement
indépendante des directions est-ouest d'âge hercynien
caractéristiques de la formation des Pyrénées.
Le fond du bassin s'est constitué à partir d'importants
dépôts fluvio-glaciaires notamment avant la deuxième
glaciation qui combla la partie orientale de cette dépression
de vases, limons et végétaux. Cette formation se
retrouve le long du fleuve Aude sous forme d'alternance d'argiles
blanches micacées à diatomées et de petits
bancs ligniteux.
La statue se trouve sur le bord d'un
chemin antique qui reliait la Cerdagne au Pays de Sault et à
la basse vallée de l'Aude jusqu'à Carcassonne. Ce
chemin était encore utilisé jusqu'au début
du XXème
siècle et constituait le seul lieu de passage par le col
des Hares pour rejoindre le Pays de Sault.
Lorsqu'on étudie la toponymie
et les textes anciens, force est de constater que le lieu où
se trouve la statue a été très fortement
influencé par la présence de celle-ci. Hormis l'appellation
du lieu dit “ Caramat ”, le chemin antique
qui passe au col des Hares, à proximité de la statue,
s'appelait encore au XIVème
siècle : “ Cami de la Pedra Picada ”
ou chemin de la pierre percée ou trouée (VIDAL 1899,
p. 462). S'il existe bien des rochers avec des gravures de croix
à la limite des départements des Pyrénées-Orientales
et de l'Ariège, il est douteux que ce soit celles-ci qui
aient donné son nom au chemin. Le toponyme “ Pedra
Picada ”, qui signifie pierre trouée, se trouve
ici au singulier, indiquant donc la présence d'une seule
pierre. Il s'agit certainement de la statue-menhir dont les yeux,
constitués de cupules profondes, font penser à des
trous.
Le problème est de savoir si cette
pierre était encore visible au XIVème
siècle, si elle était dressée ou couchée,
ou bien si le nom du lieu-dit est resté ancré profondément
dans la mémoire collective bien après son ensevelissement.
En procédant au classement des
collections préhistoriques de la Société
d'Études Scientifiques de l'Aude, en 1948, M. Barailhé
(BARAILHÉ 1949) signale l'existence de plusieurs statues-menhirs
situées dans la haute vallée de l'Aude notamment
sur le territoire de la commune d'Escouloubre. Cette commune est
mitoyenne de celle de Puyvalador. Cette note, dont la provenance
n'est pas précisée, n'attira pas l'attention des
archéologues, et les statues-menhirs de la haute vallée
de l'Aude retombèrent dans l'oubli.
En 1992, lors d'un labour plus profond
que ceux habituellement pratiqués, M. Cathala, maire de
Puyvalador, découvrait une grande dalle de plus de trois
mètres de long. Celle-ci, située en plein milieu
d'un champ, fut déplacée et posée à
proximité. A l'issue du transport, la face gravée,
qui était tournée jusqu'alors vers le sol - ce qui
a permis une bonne conservation des gravures - se retrouva en
position inverse. Au cours des mois suivants, les pluies ont lessivé
la pierre, laissant apparaître deux cupules profondes. Pour
le propriétaire du terrain, il ne s'agissait pas d'une
découverte marquante, tant les pierres à cupule
sont communes dans cette région des Pyrénées.
Ce n'est qu'en août 1994, lors
de prospections systématiques sur le territoire de la commune,
dans le cadre d'un projet de développement local - palliatif
à la désertification rurale - que Gilles Pouvreau
nous montra cette “ pierre à cupules ”.
De part sa forme générale et par le fait que les
cupules étaient concentrées en un seul endroit,
il est apparu très vite qu'il s'agissait de tout autre
chose. Une étude minutieuse de la surface de la pierre
nous permis de découvrir de très fines gravures
à peine visibles : certaines constituent un semblant de
cheveux ceints d'un bandeau, d'autres dessinent une ceinture à
damier avec une boucle. Malgré l'absence de tout autre
vestige de ce type dans la région, il s'agit bien d'une
statue-menhir. L'étude nous en fut confiée afin
de rechercher l'appartenance typologique et la datation probable
du monument.
La pierre supportant les gravures est
un granit fin de coloration gris/beige très clair. Cette
roche est d'origine locale et se retrouve en affleurement à
une centaine de mètres sur la partie ouest de la colline
de Caramat. C'est une grande dalle de 3.50 m. de hauteur sur 1.20
m. de large et 0.20 m. d'épaisseur. La face gravée
est plane alors que le dos, mal équarri, présente
de nombreuses aspérités et failles naturelles. Sa
silhouette est légèrement anthropomorphique. La
forme générale est non anatomique, mais la tête
est un peu dégagée du corps par un décroché
de la pierre dans la partie gauche. Seuls, la présence
de deux yeux profonds et le déjeté de la tête
donnent à la statue son expressivité.
Nous n'avons pas l'assurance que ces
deux cupules profondes, dont le fond possède une entaille
rectangulaire, constituent des gravures. Ces deux entailles peuvent
avoir été faites pour couper le haut de la pierre
par la technique des coins en bois que l'on mouille et qui, en
gonflant, font éclater la roche. Dans ce cas, il faudrait
en déduire que cette tentative de découpe n'a pas
été menée à son terme, pour une raison
que nous ignorons. Cette pierre est isolée et ne se trouve
pas dans une carrière. Il est donc peu probable que nous
soyons en présence d'un travail inachevé, comme
on en rencontre fréquemment sur des sites dont l'exploitation
s'est interrompue brutalement.
 On constate que la face de la statue et le décroché
de la tête n'ont pas été retravaillés
pour être l'une aplanie et l'autre creusé. Cette
morphologie est naturelle. En fait, les hommes ont choisi la pierre
et la qualité de sa surface pour en faire une statue-menhir.
On constate que la face de la statue et le décroché
de la tête n'ont pas été retravaillés
pour être l'une aplanie et l'autre creusé. Cette
morphologie est naturelle. En fait, les hommes ont choisi la pierre
et la qualité de sa surface pour en faire une statue-menhir.
Là où la gravure a enlevé
la patine colorée, le support apparaît dans sa teinte
naturelle blanchâtre, ce qui contribue à donner un
contraste de coloration et un relief particulier aux dessins.
Cette particularité est particulièrement visible
au niveau de la ceinture.
Les gravures sont peu profondes et n'ont
entamé la roche que de quelques dixièmes de millimètres
en profondeur.
La forme du visage est non anatomique.
On peut apercevoir deux yeux constitués de cupules profondes.
Ces yeux sont cerclés par des enlèvements larges
à peu près circulaires d'un demi-centimètre
de profondeur. Ces gravures sont de diamètres différents
: L'oeil gauche est plus grand que l'oeil droit. A l'intérieur
de chacune des cupules qui constituent les yeux, se trouve une
entaille horizontale de 4.0 cm de longueur et de 2.0 cm de largeur.
L'oeil gauche est surmonté d'une
croix. Les stries que l'on aperçoit dans la partie supérieure
du visage, évoquent des cheveux. Une parure de tête
- un bandeau lisse de 4.0 cm de largeur - sépare les cheveux
du reste de la statue.
Le décroché situé
dans la partie gauche de la statue esquisse l'ébauche de
la tête. Par contre, il ne dégage pas le modelé
des épaules.
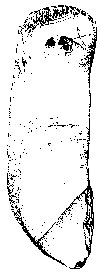 La partie inférieure du corps est un peu plus érodée,
mais on y discerne les restes d'un vêtement. Il s'agit d'une
ceinture constituée d'un bandeau droit ouvragé de
4.5 cm de largeur avec des zones rectangulaires ajourées
et des zones rectangulaires pleines alternées. Le centre
de la ceinture possède une boucle en demi-huit horizontal
déjetée vers le haut de la statue. Cette ceinture
se trouve au centre d'un bandeau plus large constitué de
deux traits parallèles grossièrement horizontaux
qui descendent légèrement vers la droite de la statue.
Sous le trait inférieur, dans la partie gauche de la statue,
il est possible d'apercevoir une série de traits horizontaux
et verticaux. Mais l'état très dégradé
de la composition ne permet pas d'augurer des intentions du graveur.
La partie inférieure du corps est un peu plus érodée,
mais on y discerne les restes d'un vêtement. Il s'agit d'une
ceinture constituée d'un bandeau droit ouvragé de
4.5 cm de largeur avec des zones rectangulaires ajourées
et des zones rectangulaires pleines alternées. Le centre
de la ceinture possède une boucle en demi-huit horizontal
déjetée vers le haut de la statue. Cette ceinture
se trouve au centre d'un bandeau plus large constitué de
deux traits parallèles grossièrement horizontaux
qui descendent légèrement vers la droite de la statue.
Sous le trait inférieur, dans la partie gauche de la statue,
il est possible d'apercevoir une série de traits horizontaux
et verticaux. Mais l'état très dégradé
de la composition ne permet pas d'augurer des intentions du graveur.
Au dos de la statue, un trait horizontal
très large et très profond entaille la partie haute
de la pierre. Bien, qu'il soit très érodé,
sa présence semble résulter d'une action volontaire.
Les gravures et les cupules ont été
obtenues par piquetage. Les ouvrages ont pu être exécutés
à l'aide de galets de quartzite dont il existe des gisements
à proximité, dans le vallon en contrebas, à
environ 50 m. de la statue, dans le lit de la rivière Aude.
On peut ranger les gravures dans deux
catégories distinctes : d'une part, celles qui forment
les yeux, les cheveux (?), le trait horizontal situé au
dos de la statue, d'autre part, celles qui composent la croix,
la ceinture, le bandeau de tête, celui du ventre, ainsi
que les traits sous la ceinture. Les premières ont été
gravées assez profondément dans la roche et sont
encore bien marquées malgré leur état très
dégradé. Les secondes ont à peine entamé
la roche et se distinguent à peine. Ces différences
dans la manière de façonner la stature pourraient
avoir pour origine une exécution échelonnée
dans un temps d'une durée plus ou moins longue. La forme
dysanthropomorphique de la pierre permet de penser que celle-ci
a été choisie à dessein pour symboliser une
figure humaine. Les yeux qui viennent renforcer cette représentation
ont dû être creusés au moment de l'érection
de la statue. Ce menhir à gros yeux, très archaïque,
suffisait sans doute à concrétiser “ l'idée anthropomorphique
ou déique ” que se faisaient les hommes de ce temps-là.
Plus tard, les autres gravures seront rajoutées, finissant
de donner un aspect humain à ce “ menhir gravé
”. Ces adjonctions peuvent provenir soit d'une évolution
des mentalités ou de l'art statuaire, soit d'une démarche
d'appropriation d'une ancienne statue par des populations plus
récentes qui y impriment leur marque en gravant leurs caractéristiques
vestimentaires.
L'absence de mobilier associé
interdit toute datation précise, et aucun indice ne permet
de rattacher cette statue à une sépulture. En raison
de son extrême simplicité dans sa forme anthropomorphique
et son dénuement au niveau des vêtements et des parures,
elle est très différente des statues-menhirs des
groupes définis par J. Landau (LANDAU 1977) et J. Arnal
(ARNAL 1985). Son dépouillement incite à la placer
dans un contexte néolithique final - chalcolithique au
sens large.
Ce pronostic, basé sur la seule
physionomie de la statue, pourrait se voir confirmé par
l'étude étymologique du toponyme et par la prise
en compte du mobilier archéologique retrouvé dans
un rayon d'un kilomètre autour de la statue. Le lieu-dit
“ Caramat ” possède une origine très
ancienne, certainement préhistorique (VIDAL 1899, p. 463).
Ce toponyme se rattache à l'ensemble des noms de lieux
relatifs aux fleuves et aux points culminants du relief (FABRE
1979). La base pré-indo-européenne est triphonématique,
la construction s'effectue à partir d'une voyelle encadrée
par deux consonnes (DAUZAT 1946). La partie sémantique
qui nous intéresse ici est “ kar ”
ou “ car ” signifiant “ la pierre ”.
Nous serions ici à la base même de la métonymie
où la matière désigne l'objet. La deuxième
moitié du nom constitué par la partie “ amat ”
ou “ ma ” plaide en faveur d'une linguistique
pré-indo-européenne d'origine méditerranéenne.
L'élargissement en “ ma ” est fréquent
dans les noms de cette origine, par exemple “ la bal-ma ”
(la grotte). On sait qu'il existait des langues parentes en Méditerranée
occidentale bien avant l'arrivée des Indo-européens
aux alentours de 2800 avant J.C.
Ce lieu-dit désigne un espace
ayant pour caractéristique la pierre que l'on retrouve
dans la racine de son nom. Or, sur tout le promontoire où
gisait la statue, aucun rocher ne se détache, qui aurait
pu donner naissance au toponyme “ Caramat ”.
On peut donc penser que la désignation du lieu à
été construite de façon métonymique
après l'élévation de la statue-menhir, à
une époque antérieure à l'arrivée
des peuples indo-européens.
A environ 900 m. du lieu de découverte,
existent quelques petites stations de plein air dont une a livré,
outre des haches polies et du mobilier céramique, des galets
à cupules opposées généralement associés
au travail du cuivre (ESPEROU 1988, p. 37 - AMBERT 1990). Il est
intéressant de constater l'association de certaines statues-menhirs
à des groupes culturels dont l'économie minière
est développée. Existerait-il un rapport entre ces
statues et l'extraction du minerai de cuivre par les premiers
paléométallurgistes ? Seules des prospections systématiques
et des fouilles plus nombreuses sur des sites miniers encore méconnus
pourraient répondre à cette question.
| Bibliographie selective
ABELANET J. (1986) - Signes sans paroles, cent siècles d'art rupestre ( Collection "La mémoire du temps" dirigée par Jean GUILAINE ), Paris, Hachette, 345 p., 74 Fig.
ABELANET J. (1990) - Les roches gravées nord-catalanes, Centre d'Études Préhistoriques Catalanes N° 5, Revista Terra Nostra, Prada, 209 p., 171 Fig., 51 Photo.
AMBERT P. - BARGE H. - BOURHIS J.-R. - ESPEROU J.-L. (1990) - Mines de cuivre préhistoriques de Cabrières, premiers résultats, in : Cabrières-Hérault : Le plus vieux centre minier métallurgique de France (2500 av. J.C.), État actuel des connaissances, in : Le Chalcolithique en Languedoc, Colloque international, hommage au Dr. J. Arnal, Saint-Mathieu de Tréviers, 20-22 Septembre 1990, Archéologie en Languedoc, pp. 13-16
ARNAL J. (1985) - Les statues menhirs, hommes et dieux, Errance, Paris, 1985
BARAILHÉ (1949) - Compte rendu des travaux de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude, séance du 20 juin 1948, in : Bulletin de la Société d'Études Scientifiques de l'Aude, Tome L, p. XXXIV
BRIARD J. (1987) - Mythes et symboles de l'Europe pré-celtique, les religions de l'Âge du bronze (2500-800 av. J.C.), Collection des Hespérides, Éditions Errance, Mortagne au Perche 1987, 177 p.
DAUZAT A. (1946) - La toponymie française, Payot, Paris. (Les problèmes des bases pré-indo-européennes), pp. 69-102
ESPEROU J.-L. (1988) - Un outil de métallurgiste aux fonctions imprécises, in : Bulletin de la Société Préhistorique Française, 1988, T. 85, N°2, p. 37 |
FABRE D. (1979) - La longue durée pastorale sur le plateau de Lacamp, quelques réflexions, in : GUILAINE Jean (1979) - L'abri Jean Cros, essai d'approche d'un groupe humain du Néolithique ancien dans son environnement., Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales, Toulouse, 1979, 461 p. (pp. 447-455)
GOGUEL J. (1950) - Géologie de la France, Que-sais-je N° 443, Presses Universitaires de France, 128 p.
GUILAINE J. (1972) - L'Âge du Bronze en Languedoc Occidental, Roussillon, Ariège, Mémoire de la Société Préhistorique Française, T. 9, Paris, KLINCKSIECK, 460 p., 134 Fig., 11 Pl. h.-t.
LANDAU J. (1977) - Les représentations anthropomorphes mégalithiques de la région méditerranéenne (3eme au 1er millénaire), Centre de Recherches Archéologiques, mémoires de l'U.R.A. 7, Vol. 1, Paris, 113 p., 25 pl. 12 cartes
RENFREW C. (1979) - Les origines de l'Europe, Flammarion, Paris, 1979, 325 p.
ROQUELAURE Abbé J.-B. de (1879) - Histoire de la haute-vallée de l'Aude, Carcassonne, imprimerie J. Parer, 333 p.
SALVAYRE H. (1983) - Géologie des Pyrénées-Orientales, essai de synthèse, Imprimerie SOFREIX, Perpignan, 104 fig., 16 tab., 8 cartes, 429 p.
VIDAL P. (1899) - Guide historique et pittoresque des Pyrénées-Orientales, 2ème édition, Librairie Saint-Martory, Alté & Fau 1899, 528 p. |